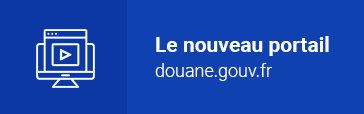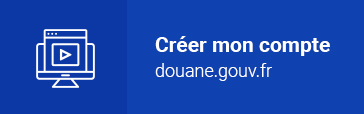Les présentes « Foires aux questions » n’ont pas de caractère contraignant en elles-mêmes. Elles visent à faciliter la mise en œuvre par les professionnels de leurs obligations en matière de LCB-FT et des mesures de gel des avoirs. Elles sont complémentaires des autres documents explicatifs publiés par la DGDDI.
Sommaire de la FAQ
- FAQ communes
- FAQ Marchands d'art et d'antiquités
- FAQ Opérateurs de ventes volontaires
- FAQ Négociants de pierres et métaux précieux
FAQ Communes
Généralités
Près d’une quinzaine de secteurs d’activité représentant près de 50 professions et plus de 200 000 professionnels sont assujettis en France à la réglementation LCB-FT : établissements bancaires, sociétés de transfert de fonds, changeurs manuels, avocats, notaires, experts-comptables, casinos et opérateurs de jeux, agents immobiliers, marchands d’art et de luxe…
En assurant la traçabilité des opérations qu’ils réalisent et en transmettant à Tracfin leurs déclarations de soupçon, ces professionnels constituent la première ligne de défense contre le détournement de leur secteur à but de blanchiment.
La liste de ces professions est prévue par l’article L.561-2 du code monétaire et financier.
Les obligations LCB-FT existent dans d’autres Etats que la France. Cette réglementation découle en effet des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI). En application de celles-ci, plus de 200 Etats et organisations internationales à travers le monde déploient un système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ces recommandations sont déclinées au sein de l’Union Européenne par une série de directives anti-blanchiment. Le cadre actuel, établi par la transposition de la 5e directive européenne anti-blanchiment, sera remplacé en juillet 2027 par l’entrée en vigueur d’un règlement européen unique, d’une 6e directive et la mise en place d’une nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment, harmonisant la règlementation LCB-FT et son application entre les Etats membres.
La règlementation LCB-FT est identique pour tous les professionnels assujettis, quel que soit le secteur d’activité, la taille de la société ou le volume d’activité.
Toutefois, les modalités pratiques de mise en œuvre des obligations LCB-FT dépendent de l’exposition aux risques BC-FT du professionnel assujetti et de ses capacités financières et humaines. Les modalités de déploiement d’un dispositif LCB-FT est ainsi différent entre un établissement bancaire international et un marchand d’art à la tête d’une société unipersonnelle.
Pour les professionnels placés sous la supervision de la douane, la règlementation LCB-FT s’applique uniquement lorsque la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000€.
Les obligations en matière de LCB-FT sont des obligations légales qui justifient la collecte et le traitement de données personnelles au sens de la règlementation sur la protection des données.
La minimisation des données est similaire à la notion d’approche par les risques en LCB-FT. Les professionnels veillent par ailleurs au respect des autres obligations relatives à la protection des données, telles que la loyauté et la transparence sur les catégories de données traitées, leur base légale, la finalité du traitement, l’identité du responsable du traitement et la durée de conservation.
Pour en savoir plus, les professionnels peuvent consulter le site internet de la CNIL
La sélection des professionnels qui font l’objet d’un contrôle LCB-FT est réalisée selon une approche par les risques tels qu’identifiés dans les analyses sectorielles des risques BC-FT, disponibles sur le site internet de la douane.
En cas de contrôle, les agents des douanes se déplacent dans les locaux du professionnel assujetti. Le contrôle se déroule en deux temps :
Le professionnel présente le dispositif LCB-FT de sa société et la mise en œuvre de ses obligations
Les agents des douanes sélectionnent un nombre représentatif d’opérations effectuées par la société pour s’assurer que les obligations ont été mises en œuvre.
A l’issue du contrôle sur place, les agents des douanes exploitent les documents saisis, peuvent demander des documents complémentaires et un rapport est rédigé.
Les agents des douanes décident des suites à donner en fonction de la constatation ou non de manquements et de leur gravité :
- Avis de fin de contrôle, lorsqu’aucun manquement n’est constaté ;
- Envoi d’une lettre d’injonction de mise en conformité au professionnel contrôlé ;
- Transmission du rapport de contrôle à la Commission Nationale des Sanctions (CNS) pour ouverture d’une procédure de sanction.
La lettre d’injonction de mise en conformité liste les améliorations que le professionnel doit apporter à son dispositif LCB-FT dans un délai donné. L’envoi d’une lettre d’injonction peut être doublé d’une transmission du rapport de contrôle à la Commission Nationale des Sanctions (CNS).
Au terme de ce délai, une évaluation des mesures de remédiation apportées est effectuée par les agents des douanes. Dans le cas où elles seraient jugées insuffisantes, le dossier peut être transmis à la Commission Nationale des Sanctions (CNS).
La Commission Nationale des Sanctions (CNS), est l’autorité de sanction des professionnels supervisés par la douane. Sur la base du rapport de contrôle de la douane, elle notifie des griefs au professionnel concerné dans le cadre de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Le professionnel encourt :
Des sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, retrait de son agrément professionnel, interdiction temporaire ou définitive d’exercer son activité
Des sanctions pécuniaires : une pénalité allant jusqu’à 5 000 000€ pour la personne morale et ses dirigeants
De plus, la CNS peut prononcer la fermeture administrative temporaire ou définitive de l’établissement ainsi que la publication de la décision, aux frais du professionnel, dans des revues spécialisées
Les décisions rendues par la CNS sont publiques, elles peuvent être anonymes ou nominatives. Elles sont consultables sur le site internet de la CNS.
A la suite du prononcé de la sanction par la CNS, la douane émet une lettre d’injonction de mise en conformité qui reprend l’intégralité des griefs retenus par la Commission.
A l’issue du délai accordé pour se mettre en conformité, une évaluation des mesures de remédiation apportées est effectuée par les agents des douanes. Dans le cas où elles seraient jugées insuffisantes, le dossier peut être transmis de nouveau à la CNS et aboutir à une deuxième sanction.
Plusieurs organisations professionnelles et prestataires de services proposent des documents type (classification des risques, procédure LCB-FT) à destination de leurs membres ou clients. Ces documents concourent à une meilleure appropriation de la règlementation LCB-FT par les professionnels déclarants.
La douane ne préjuge pas de la bonne mise en œuvre des obligations LCB-FT par l’existence d’un dispositif élaboré par un conseil ou une organisation professionnelle et n’accrédite aucun de ces documents.
La douane appelle l’attention sur la nécessaire adaptation de ces documents à l’activité et l’organisation du professionnel déclarant qui demeure responsable des carences qui pourraient être constatées dans le cadre d’un contrôle.
Plusieurs prestataires offrent des solutions de conformité LCB-FT qui peuvent constituer des outils d‘accompagnement à la mise en œuvre des diligences qui incombent aux professionnels. Le recours à ces derniers n’est en aucun cas obligatoire.
La douane ne préjuge pas de la bonne mise en œuvre des obligations LCB-FT par l’existence de tels outils informatiques et n’en accrédite aucun.
Ces solutions doivent impérativement être adaptées aux caractéristiques de l’activité du professionnel qui y a recours. Le professionnel déclarant demeure responsable des carences qui pourraient être constatées dans le cadre d’un contrôle.
Une entité qui n’emploierait qu’une personne adapte son dispositif en mettant en place des modalités de contrôle simplifiées tant sur la forme (check-list) que sur le fond (fréquence des contrôles et taille des échantillons plus réduite).
À titre d’exemple, le professionnel pourra contrôler le bon fonctionnement de ses outils de criblage sur le gel des avoirs en les testant régulièrement sur un nombre limité d’identités de personnes concernées par la réglementation.
L’obligation de formation du personnel s’applique aux dirigeants et aux collaborateurs qui sont en contact avec la clientèle et effectuent des opérations ainsi qu’aux employés qui assurent des fonctions dans le cadre de la conformité et du contrôle interne.
Pour permettre à la douane d’évaluer le respect de l’obligation de formation par un professionnel donné, il est recommandé de conserver un document attestant la présence de l’ensemble des collaborateurs de la société concernée aux formations ainsi que le contenu de la formation.
Suivre une simple réunion d’information ou adhérer à un syndicat professionnel ne constituent pas en tant que tel une formation LCB-FT.
Pour les professionnels supervisés par la douane, l’application des obligations LCB-FT ne s’applique que pour les opérations supérieures au seuil de 10 000€. Le professionnel déclarant n’a pas à mettre en œuvre les obligations LCB-FT pour les opérations d’un montant inférieur à ce montant.
Il doit toutefois accorder une attention particulière aux opérations fractionnées, mode opératoire qui consiste à multiplier les transactions d’un montant inférieur aux seuils réglementaires pour contourner les obligations de vigilance.
Le professionnel assujetti doit également appliquer les mesures de gel des avoirs quel que soit le montant de l’opération.
Le code monétaire et financier ne définit pas ce qu’est une opération liée. Peuvent être considérées comme telles, deux opérations ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée.
Deux opérations ou plus d’un montant unitaire inférieur au seuil d’assujettissement de 10 000€ peuvent donc faire l’objet d’une surveillance lorsqu’elles sont considérées comme liées et dépassent, cumulées, ce seuil.
Ces critères sont définis par le professionnel lui-même dans sa procédure interne LCB-FT et tiennent compte des spécificités de son activité.
Les PPE sont des personnes considérées par la loi comme exposées à des « risques plus élevés » de corruption en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elles exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an. La corruption recouvre notamment le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de recevoir une somme d’argent ou un don, afin qu’elle accomplisse ou qu’elle s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.
La loi ne fixe pas la liste nominative des personnes politiquement exposées mais définit les fonctions exercées qui entrainent ce statut.
Les personnes politiquement exposées peuvent exercer les fonctions suivantes :
- Chef d'état, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- Membres d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
- Membres d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- Membre d'une cour des comptes ;
- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- Dirigeant d'une institution internationale publique au titre d'un traité.
- Attention, les proches des personnes occupant de telles fonctions sont également considérées comme personnes politiquement exposées. Sont visés, le ou la conjoint(e) (peu importe la nature de l’alliance), les parents, les enfants ainsi que leur conjoint et les personnes étroitement associées aux PPE.
Est considérée comme une personne étroitement associée à une personne politiquement exposée :
Une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne ;
Une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée.
La règlementation fixe uniquement une liste des fonctions attribuant la qualité de PPE et non une liste nominative de ces personnes.
Un répertoire public n’existe pas, cependant, des listes privées payantes sont disponibles. Si celles-ci facilitent la mise en œuvre des obligations LCB-FT et la détection des PPE, elles ne sont pas obligatoires.
La détection des personnes politiquement exposées est obligatoire.
Le professionnel peut, par exemple, demander directement à son client s’il est une personne politiquement exposée, l’interroger sur sa profession et comparer à la liste des fonctions conférant la qualité de PPE, effectuer des recherches en sources ouvertes ou recourir à une liste fournie par un prestataire privé.
Dans le cadre de ses contrôles, la douane contrôle l’existence du dispositif de détection des PPE et l’adéquation des mesures de vigilance mises en œuvre par le professionnel sur ces personnes.
La douane met à disposition, sur son site internet, la liste actualisée des pays figurant sur les listes du GAFI et de la Commission européenne. Les flux économiques en lien avec ces Etats nécessitent une vigilance accrue des professionnels.
Les professionnels assujettis à la réglementation LCB-FT ont un droit d’accès au registre des bénéficiaires effectifs accessible sur le site de l’INPI et peuvent identifier les bénéficiaires effectifs d’une personne morale française en consultant ce registre (accès gratuit).
Pour connaitre les formalités d’inscription, nous vous invitons à consulter la page internet dédiée (RBE).
Lorsque le client est en relation d’affaires, le professionnel a l’obligation de recueillir des éléments de connaissance clientèle. Les éléments susceptibles d’être collectés sont listés par l’arrêté du 2 septembre 2009.
Le code monétaire et financier ne précise pas les modalités de recueil de ces informations, une bonne pratique consiste en la complétion d’une fiche client par le professionnel ou le client lui-même.
Pour les aider dans l’élaboration de leur fiche client, les professionnels peuvent consulter deux exemples de fiches clients (fiche client 1[PDF], fiche client 2 [PDF]). Ces documents sont inspirés de pratiques de professionnels et ont été anonymisés.
Le fait d’acheter/vendre un bien à un confère, lui-même assujetti aux obligations LCB-FT ne justifie pas à lui seul, d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées. Par défaut, en application de la réglementation, le niveau de risque est considéré comme « modéré » et une vigilance constante est attendue sur les clients en relation d’affaires ne présentant pas de risque spécifique.
Lorsque le professionnel estime que le risque de BC-FT est faible, il doit le justifier. L’administration des douanes peut remettre en cause cette qualification en cas de contrôle et constater, dès lors, des manquements aux obligations de vigilance.
Le rythme d’actualisation des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires varie selon le degré de vigilance.
Le fait d’acheter/vendre un bien à un client avec lequel le professionnel commerce depuis longtemps ne justifie pas, à lui seul, d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées. Par défaut, en application de la réglementation, le niveau de risque est considéré comme « modéré » et une vigilance constante est attendue sur les clients en relation d’affaires ne présentant pas de risque spécifique.
Lorsque le professionnel estime que le risque de BC-FT est faible, il doit le justifier. L’administration des douanes peut remettre en cause cette qualification en cas de contrôle et constater, dès lors, des manquements aux obligations de vigilance.
Le rythme d’actualisation des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires varie selon le degré de vigilance.
Le code monétaire et financier prévoit expressément l’interdiction pour le professionnel d’exécuter l’opération s’il ne peut pas identifier le client ou son bénéficiaire effectif (article L.561-8 du CMF).
Le professionnel est alors invité à effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin au titre de la tentative d’opération prévue au V de l’article L.561-15 du CMF.ion.
Le code monétaire et financier prévoit expressément que lorsque le client refuse de communiquer des informations sur la provenance des fonds ou les motifs avancés des paiements, le professionnel effectue une déclaration de soupçon à Tracfin selon le motif de « soupçon de fraude fiscale » (articles L.561-15 et D.561-32-1 du CMF).
Le professionnel doit s’attacher à évaluer la cohérence entre le profil du client et l’opération envisagée. Dans certains cas, en fonction du niveau de risque BC-FT que présente le client ou l’opération, un justificatif d’achat, telle qu’une facture, ou un autre document justifiant de l’obtention légale du bien telle qu’un acte de succession ou de donation peuvent être demandés.
Un tel document n’est donc pas obligatoire de manière systématique mais en fonction du niveau de risque que présente la relation d’affaires ou l’opération. Le professionnel peut notamment déterminer dans sa procédure interne LCB-FT que lorsqu’une transaction dépasse un montant pré-déterminé, il demande un justificatif de provenance/d’achat.
La modification d’une facture à la demande de l’acheteur est un signal d’alerte, susceptible de nécessiter des recherches complémentaires.
Dans une telle situation, le professionnel est invité à effectuer un examen renforcé, c’est-à-dire rechercher l’origine des fonds, l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Le professionnel peut demander directement à son client la raison du changement de nom sur la facture.
Si la réponse du client ne permet pas au professionnel d’établir la cohérence de l’opération et la raison légitime pour cette demande de changement, le professionnel doit transmettre une déclaration de soupçon à Tracfin.
La décision de mettre un terme ou non à la relation d’affaires après avoir effectué une déclaration de soupçon appartient au professionnel et relève de sa seule responsabilité. Seules l’incapacité de vérifier l’identité du client ou de recueillir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires conduisent à une cessation automatique de la relation d’affaires avec le client.
La déclaration de soupçon revêt un caractère strictement confidentiel (article L.561-18 du CMF). Ce principe général de confidentialité s’applique à l’existence de la déclaration de soupçon, mais aussi à son contenu et aux suites qui lui sont données.
Tracfin place la confidentialité des déclarations et la protection du déclarant au cœur du dispositif LCB-FT. Ainsi, quand Tracfin transmet une note d’information à l’autorité judiciaire ou à une autre administration, il a l’obligation légale de ne jamais mentionner l’origine de cette information. En cas d’impossibilité de garantir l’anonymat d’un déclarant, aucune information n’est transmise. Tracfin s’assure de l’anonymat du déclarant en recoupant l’information provenant de plusieurs déclarants assujettis.
Les professionnels déclarants doivent appliquer les mesures restrictives pour l’intégralité des opérations qu’ils réalisent, quel qu’en soit le montant. Ils doivent s’assurer que leur partenaire commercial et le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération n’est pas visé par une mesure de gel des avoirs.
Pour se faire, le professionnel consulte le registre de gel des avoirs disponible sur le site internet de la Direction Générale du Trésor. Le filtrage doit se réaliser avant la réalisation de la transaction.
Le professionnel consigne les documents recueillis et les recherches effectuées (i.e. capture écran).
Les professionnels déclarants doivent appliquer les mesures restrictives pour l’intégralité des opérations.
Il relève de la responsabilité des opérateurs de s’assurer que l’opération commerciale qu’ils envisagent n’entre pas dans le champ d’application matériel et géographique d’une mesure de restriction commerciale.
Pour en savoir plus : Démarche : Généralités sur les embargos | Portail de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Si le professionnel constate que le client est visé par une telle mesure, il en informe immédiatement, la Direction générale du Trésor (sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr), procède à une déclaration de soupçon à Tracfin au titre de la tentative d’opération (articles L.561-15) et n’exécute pas la transact.
La signature d’un mandat de vente déclenche le passage au statut de relation d’affaires puisqu’elle s’inscrit dans la durée. Ainsi, les documents nécessaires à la vérification d’identité du client et à la connaissance client doivent être recueillis au moment de l’entrée en relation d’affaires, c’est à dire à la signature de ce mandat.
L’essentiel des mesures de vigilance porte sur le client procédant au paiement de l’opération mais le professionnel doit au minimum déterminer qu’il s’agit d’un achat à demi et identifier les bénéficiaires effectifs de l’opération, c’est-à-dire les autres marchands concourant à la transaction.
Dans le cas où le paiement provient d’individus n’ayant pas été identifiés par le professionnel, il doit procéder à minima à un examen renforcé et peut le cas échéant transmettre une déclaration de soupçon à Tracfin.
La mise en œuvre des mesures de vigilance dépend de la place du professionnel dans l’opération :
- Le professionnel est face à l’acheteur final : il applique les mesures de vigilance LCB-FT
- Le professionnel a participé à l’opération mais un confrère a effectué la vente : il doit être en mesure d’obtenir les informations pertinentes relatives à la transaction pour satisfaire aux obligations LCB-FT.
Un protocole de partage d’informations peut être mis en place pour permettre, sur première demande des autres vendeurs à demi, de prendre connaissance des éléments recueillis dans le cadre de la LCB-FT (pièce d’identité, éléments de connaissance clientèle, caractéristiques de l’opération).
Les conditions d’exercice dans le cadre des salons et foires peuvent nécessiter des adaptations dans les modalités de mise en œuvre des obligations LCB-FT.
A cette fin, le professionnel détermine si le client est en relation d’affaires ou occasionnel :
- Si le client est en relation d’affaires, le professionnel connait déjà son client pour lequel il dispose donc d’éléments de connaissance clientèle qu’il peut actualiser le cas échéant. Il applique les mesures de vigilance adaptées au risque BC-FT de la relation d’affaires en application de la notation de la relation d’affaires déjà déterminée. Au moment de l’exécution de l’opération lors d’un salon, le professionnel doit simplement s’assurer que l’opération envisagée soit en cohérence avec la connaissance qu’il a de son client.
- Si le client est occasionnel, situation la plus fréquente lors d’un salon ou d’une foire, l’essentiel des obligations LCB-FT consiste à identifier et vérifier l’identité du client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et procéder à un examen renforcé lorsque l’opération :
- Est particulièrement complexe ;
- Est d’un montant inhabituellement élevé ;
- Ne semble pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
- Cas spécifique de l’entrée en relation d’affaires à l’occasion d’un salon ou foire : du fait des conditions d’exercice, l’obtention de l’ensemble des informations LCB-FT peut s’avérer compliquée lorsqu’une relation d’affaires est nouée lors du salon. Sous réserve d’une livraison de l’œuvre a posteriori, il est possible pour le professionnel de finaliser la mise en œuvre de ses obligations LCB-FT après la fin du salon et avant la livraison de l’œuvre.
En tout état de cause, le professionnel n’exécute pas l’opération s’il a un doute quant à l’origine licite ou illicite des fonds utilisés pour l’exécution de l’opération. Il procède le cas échéant à une déclaration de soupçon à Tracfin qui peut être adressée après la clôture du salon.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent appliquer les obligations LCB-FT lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros.
- Pour le client mandant :
La transaction s’entend comme le montant de la transaction financière entre l’opérateur et son client mandant, soit le prix marteau minoré des frais vendeur.
Le seuil de 10 000€ affiché sur le bordereau de dépôt vendeur déclenche l’application des obligations LCB-FT pour le client mandant. Le seuil peut être atteint par la mise en vente d’un bien individuel ou d’un groupe de biens déposés par le mandant.
Dans le cas où un bien d’une valeur inférieure à 10 000€ apporté par un client mandant est inclus dans un bordereau d’adjudication qui, lui, dépasse 10 000€, l’opérateur de vente volontaire n’a pas à procéder à l’application des obligations LCB-FT sur le mandant.
- Pour le client adjudicataire :
La transaction s’entend comme le montant de la transaction financière entre l’opérateur et son client adjudicataire, soit le prix marteau majoré des frais acheteur.
Le seuil de 10 000€ affiché sur le bordereau d’adjudication déclenche l’application des obligations LCB-FT pour le client adjudicataire. Le seuil peut être atteint par l’achat d’un bien individuel ou d’un groupe de biens lors d’une même vacation.
Mise en œuvre des obligations LCB-FT sur le client mandant
Si au moment de l’estimation du bien, le montant de celui-ci dépasse le seuil de 10 000€, le professionnel peut anticiper l’application des obligations LCB-FT sur son client mandant.
Les obligations LCB-FT ne sont à mettre en œuvre qu’à partir du seuil de 10 000€. Si le montant d’adjudication dépasse ce seuil, le professionnel doit mettre en œuvre les obligations LCB-FT sur le mandant après l’adjudication.
Mise en œuvre des obligations LCB-FT sur le client adjudicataire
La notion d’opération liée n’est pas définie par le code monétaire et financier. Le professionnel doit lui-même déterminer dans sa procédure interne LCB-FT les critères lui permettant de les identifier, notamment la période de temps entre plusieurs opérations réalisées par le même client.
Il peut pour cela prendre en compte les pratiques habituelles d’achat et vente de sa maison de ventes pour déterminer ces critères.
Mise en œuvre des obligations LCB-FT et des sanctions financières ciblées par les diamantaires dans le cadre d’un contrat de « dépôt-confié »
Le contrat de « dépôt-confié » permet de confier des pierres à un client, sans transfert de propriété. La réalisation de la transaction intervient ultérieurement, au même moment que le transfert de propriété, lorsque le client informe le diamantaire de son souhait d’acheter les pierres. La facturation et la transaction financière afférente peuvent ainsi intervenir dans un second temps.
- Lorsque le professionnel agit en tant que fournisseur et qu’il confie des pierres à un client, il doit s’assurer que son client n’est pas visé par une mesure de gel des avoirs avant la remise des pierres. Si durant le confié, le client devient visé par une telle mesure, le diamantaire doit en informer immédiatement la Direction générale du Trésor.
- Lorsque le professionnel agit en tant que client et qu’on lui confie des pierres, il doit s’assurer que son client, le fournisseur, n’est pas visé par une mesure de gel des avoirs avant le paiement des pierres.
Cette vérification doit se faire quel que soit le montant des pierres confiées (indépendamment du seuil de 10 000€ applicable pour les obligations LCB-FT).
Sous réserve d’atteindre le seuil d’assujettissement (cf « détermination du seuil d’assujettissement »), le contrat de « dépôt-confié » fait naître des obligations pour les parties qui s’échelonnent dans le temps : les clients doivent donc être considérés en relation d’affaires. Dès lors, le professionnel doit recueillir des données de connaissance clientèle (KYC) et évaluer le niveau de risque de la relation d’affaires.
Le professionnel doit appliquer des mesures de vigilance adaptées au niveau de risque de celle-ci et surveiller les transactions réalisées au cours de la relation d’affaires (ex : le nombre de pierres achetées sur une période donnée est-il cohérent par rapport aux achats réalisés par le passé par ce client). La fréquence et l’intensité de ces vérifications dépendent du niveau de risque de la relation d’affaires.
En tout état de cause et quel que soit le niveau de risque de la relation d’affaires, le professionnel devra conduire un examen renforcé en fonction des caractéristiques de l’opération lorsqu’elle :
- Est particulièrement complexe ou ;
- Est d’un montant inhabituellement élevé ou ;
- Ne semble pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Il est fréquent qu’un client achète une partie seulement des diamants confiés et retourne ceux non-sélectionnés. Il existe alors une différence entre la valeur des pierres confiées initialement et la valeur des pierres achetées.
Le seuil de transaction de 10 000€ est atteint en considération des pierres réellement achetées.
Le professionnel doit considérer comme liées, deux opérations ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée.
Le professionnel peut ainsi considérer que des pierres vendues, dont le montant unitaire est inférieur à 10 000€, mais dont le montant total dépasse ce seuil, sont liées.
Le seuil de 10 000€ peut être atteint :
- Au moment où le client informe le diamantaire de son souhait d’acheter un ou plusieurs diamants (matérialisation de la transaction), dont le montant total est égal ou supérieur à 10 000€.
Par exemple : Un diamantaire confie à son client :- Lors d’une livraison A : 20 diamants d’une valeur unitaire de 1 000€
- Quelques jours plus tard, lors d’une livraison B : 9 diamants, d’une valeur unitaire de 1 500.
Suite à cette seconde livraison, le client informe le diamantaire qu’il souhaite acheter 6 diamants du premier confié, et 5 diamants du second confié. Le montant de la transaction est ici de 13 500€ (6 x 1000€ + 5 x 1500€).
- Au moment où une facture est établie, regroupant plusieurs transactions, dont le montant est égal ou supérieur à 10 000€
Par exemple : un diamantaire confie à son client :- Lors d’une livraison A, 20 diamants d’un montant unitaire de 300€
- Lors d’une livraison B, 15 diamants d’un montant unitaire de 200€. Le client signifie au diamantaire qu’il souhaite acheter l’intégralité des diamants confiés. Le montant de la transaction est ici de 9 000€ (20 x 300€ + 15 x 200€).
Quelques semaines plus tard, le diamantaire confie à son client : - 10 diamants d’une valeur unitaire de 500€.
Le client informe à la suite de cette livraison qu’il achète 8 de ces diamants. La seconde transaction est d’un montant de 4 000€ (8 x 500€).
Le diamantaire regroupe la transaction n°1 d’un montant de 9 000€ et la transaction n°2 d’un montant de 4 000€ sur une seule et même facture d’un montant total de 13 000€. Le diamantaire doit retenir le montant total de la facture pour déterminer si le seuil de 10 000€ est atteint.
Cas n°1 : Les pierres sont directement achetées par le donneur d’ordre
- S’agissant de l’application des sanctions financières ciblées : le diamantaire vérifie que le sous-traitant et le donneur d’ordre ne sont pas visés par une mesure de gel des avoirs, avant la remise des pierres
- S’agissant des mesures de vigilance : le diamantaire vérifie uniquement la cohérence de la transaction avec les caractéristiques de l’opération et la connaissance qu’il a de la relation d’affaires avec le donneur d’ordre, son client. Par exemple : le diamantaire vérifie que l’adresse de livraison des pierres correspond bien à l’adresse du sous-traitant désigné par le donneur d’ordre.
Cas n°2 : Les pierres sont achetées par le sous-traitant
- S’agissant de l’application des sanctions financières ciblées : le diamantaire vérifie que le sous-traitant et le donneur d’ordre ne sont pas visés par une mesure de gel des avoirs, avant la remise des pierres
- S’agissant des mesures de vigilance : le sous-traitant est ici considéré comme intermédiaire, agissant pour le compte du client final et prend part à l’opération financière. Le diamantaire doit alors identifier et vérifier l’identité du sous-traitant et du client final (le donneur d’ordre) et appliquer les mesures de vigilance sur le sous-traitant.
Pour solliciter la DNRED sur toute demande relative à la mise en oeuvre des obligations LCB-FT :